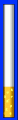ALGER...
Alger...
Au plus profond de mon exil canadien aux longs et redoutables frimas, me revenait sans cesse un rêve qui réchauffait un moment mon âme et les jours sombres et froids. Le même rêve toujours d’une promenade sur les hauteurs d’Alger au lieu-dit Balcon St-Raphael. Immobile devant la balustrade du parc surplombant la ville, mon regard embrasse loin au-delà des limites de la cité jusqu’aux contreforts des montagnes du Djurdjura.
Par beau temps, j’aperçois le mont Lalla Khadidja avec, jusqu’en avril, son pic neigeux, point lumineux et fixe où le regard s’accroche un instant, comme hypnotisé, pour redescendre lentement vers les basses terres et les petits villages côtiers qui s’égrènent le long de la baie, coquillages blancs et luisants léchés par le soleil et la brume marine.
La ville est là à mes pieds, magnifique et claire, détachée du monde, alanguie, gisante, avançant ses bras loin dans la mer comme pour aller chercher au-delà de l’horizon un peu de vitalité et de sève, ne sachant pas trouver en elle tout ce qu’elle porte pourtant.
De cette hauteur, nul bruit ni agitation, rien qui ne laisse deviner la cohue et le mouvement des foules, la circulation des véhicules envahissants les rues tortueuses dans des poussières grises faisant souffrir les fragiles poumons en mal d’air pur et sec. À certaines heures, il faudrait porter un masque comme dans ces grandes villes d’Asie; mais ici, a-t-on idée de reprocher quoique ce soit à cette ville et de lui faire subir un tel affront?
À mes pieds, j’entends le bruit d’eau d’une maigre rigole qui coule en cascade à travers les buissons dans des sillons de terre rouge et ce murmure est comme un écho au battement sourd et profond de la masse turquoise bordant la ville.
Autour de moi, une végétation dense et touffue, des ficus et des figuiers en grande part, et l’air, l’air chargé des odeurs douces de la terre et de celle entêtante et poivrée des lentisques partout présents.
Au premier abord, la ville ne semble être qu’un bloc blanc et compact, une boule étincelante. Puis, au bout d’un moment, l’esprit se résout à délier ce bel ensemble et quelques lignes apparaissent ici et là. Tout en bas, on suit la route Moutonnière qui longe la mer reliant l’est et l’ouest, éclaboussée d’eau les jours de tempête quand la mer refuse de pactiser avec ce ruban de béton. Longtemps, cette route fut un des rares symboles d’une modernité fièrement affichée. Ici, il aurait plutôt fallu un petit train où assis sur la banquette, le visage collé à la vitre, on aurait pu se laisser porter par le roulis du rail et la clameur de l’eau. Voyage à peu de frais entre terre et mer et, à certains moments, dans les lointains replis du songe. Un luxe donc !
Encore plus bas, le port et la darse de l’Amirauté, un monde en soi n’appartenant ni tout à fait à la cité ni tout à fait à la mer. On va y travailler ou voler un moment de liberté et, durant ces heures passées là, en nous quelque chose se rompt du lien qui nous lie à la ville. On y pressent la douleur des départs de ceux qui, en s’éloignant d’elle ignorent si leur regard caressera à nouveau ses contours. Et, c’est finalement heureux et soulagé que l’on retourne dans la ville, à sa vie et ses contraintes.
Le regard oblique à l’ouest et bloque sur un amas de constructions carrées, serrées dont on ne distingue que les terrasses en paliers. La Casbah et ses hauteurs ne sont plus, et depuis longtemps, l’âme de cette ville comme aux plus beaux jours de sa splendeur, tout au plus demeurent-elles le repaire des plus fidèles de ses habitants, de ceux qui, entre ses murs décrépis, peuvent s’enorgueillir de n’avoir rien cédé au temps qui passe et aux glorioles de la modernité.
Il faut faire preuve de beaucoup de curiosité et d’un effort marqué pour aller au-delà de cet ensemble arabo-turc, de l’autre côté, là où une petite baie se la joue solitaire et populaire à la fois, accolée au quartier de Bab-el-oued et à ses ruelles sans air les nuits de canicule qui font, au petit matin, ressembler ses habitants à des zombies pâles et fatigués, un comble pour un pays de soleil !
Ici, point de jardins ni de verdure si ce n’est au bout de la petite corniche le cimetière chrétien depuis longtemps abandonné, seul parmi les hommes de notre époque.
Sur la plage, les enfants s’ébattent en criant sans se soucier des énormes bouches qui rejettent dans l’écume marine des flots d’eaux vertes et grises.
Sans trop de regret, le regard quitte cette partie de la ville et se tourne vers l’est tout entier ouvert et riche de promesses. De ce côté, nulle entrave au vent. On ouvre ses poumons pour aspirer l’air qui semble arriver droit des montagnes. Un air pur, nous parait-il, qui viendrait chasser celui plus lourd de la ville en dessous. Les yeux clignent pour aller chercher la moindre étincelle de blanc, de vert, de bleu que le lointain nous renvoie. Et si, un moment, on suit la courbe du ciel, le spectacle de la lente et silencieuse marche des nuages s’offre à nous : une danseuse, le front ceint d’un bandeau blanc immaculé, et dont les bras sont des ailes duveteuses, bat l’air bleu. Derrière elle, un cheval fougueux et vif traverse le ciel dans une figure figée de galop. Et là l’étreinte voluptueuse et tendre de deux amants qui procure un manteau de félicité aux humains en dessous.
J’esquisse un sourire, des pensées se bousculent dans ma tête, intimes et douces, certaines étranges et confuses, sans contours, pur moment de rêverie proche du néant et de son gouffre.
Au dessus de ma tête, se dessinent les traits flous d’un visage aux paupières closes que les rayons du soleil illuminent de l’intérieur. Une fraction de seconde, il me semble y voir le visage de l’aimé, chassé aussitôt par l’image sombre de la mort.
À cet instant, un frisson me parcourt et j’essaye d’arrêter le flux envahissant de mes pensées. Pour calmer mon tumulte intérieur, je cherche des mots, des vers, que sais-je, qui me ramèneraient au bonheur brut et limpide qui était le mien quelques instants auparavant. Ce sont finalement les paroles d’un tango algérois qui viendront m’apaiser…Ana el warka el meskina…
Voici en bas, là, le lieu où tout a commencé pour moi dans un deux pièces sombre et humide du boulevard Cervantès, faisant face à la grotte où l’écrivain-aventurier fut emprisonné par les turcs après une bataille épique sur un bateau au large de la ville.
On disait Cervantès pour nommer le quartier en entier au centre duquel serpentait le boulevard et surgissaient alors à l’esprit mille images de chaleur poisseuse, de rues populeuses et sales où les enfants inventaient leurs jeux, d’ouvriers trainant après le travail d’énormes pastèques à partager dans des logis aveugles et sans air, de boutiques étroites aux lumières blafardes.
Longtemps, je portais mon lieu de naissance comme une tare dont je taisais le nom, et, s’il me fallait m’expliquer à ce sujet, je répondais que j’étais née à Belcourt, ce qui n’est pas complètement faux, puisque Cervantès se trouve précisément à l’extrémité est du quartier de Belcourt.
Un battement de cœur et mon regard remonte vers Diar Es Saada, la Cité du bonheur que Fernand Pouillon dans les années’50 voulut avant-gardiste à l’image d’une Brasilia !
Dédale d’immeubles et de places, sa couleur évoque le sable des déserts et les ouvertures des fenêtres sont comme des yeux cherchant pour les occupants un destin heureux et tranquille. Ici comme ailleurs, le linge que l’on sèche aux fenêtres, les odeurs de cuisine qui se mélangent et les multitudes d’enfants ont tôt fait d’algérianiser les lieux mais la vie y est-elle meilleure qu’ailleurs comme le rêvait l’architecte ?
À Alger, pas de grattes ciel de verre et de béton. Cette ville ignore les hauteurs si ce n’est celle que la colline sur laquelle elle s’agrippe lui procure.
Son ambition n’est pas de montrer ni de créer. Elle ne parle pas encore le langage de la modernité. Aux autres les idées de grandeur, à elle l’assoupissement béat aux soubresauts tragiques. Elle ne prétend à rien, ses hommes ne cherchant plus qu’à prendre revanche sur le passé et à réaliser leur destin.
Elle dort dans sa nuit laiteuse aux trainées sanguines, ne sachant pas encore comment s’éveiller aux lumières du présent, recluse, cachée derrière des voiles sombres et tristes.
Pourtant, sous ses allures résignées, un volcan bout en elle qui, par moment, explose de tout son sang rouge et chaud. Et puis, au matin clair et soyeux de ses souffrances, une brise l’enveloppe et, toutes larmes séchées, la voilà qui redevient, pour un temps, lumière et bonté - invincible -
Comme elle, j’ai survécu à toutes mes douleurs et n’attend rien que le prochain printemps et mon rêve, mon merveilleux rêve fondu dans les replis de mon cerveau qui me restitue certaines nuits solitaires, ma ville natale, intacte, éternelle.
Djaouida Chalal
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021