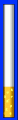SOUVENIR D'UN JUILLET 1962
UN SOUVENIR DE KHERRATA
JUILLET 1962
Depuis une semaine, la pluie tombe inlassablement en gouttes chantantes aux accents d’acier. Une musique monotone accordée à la couleur grise du ciel. Parfois, le rythme s’accélère, des rigoles d’eaux boueuses rougeâtres dévalent les pentes charriant cailloux, morceaux de bois, débris métalliques.
La haie de platanes qui borde notre rue me paraît sombre, menaçante.
À l’intérieur de la maison, les murs suintent de toutes parts. Le poêle à bois de la cuisine ainsi que le brasero que nous trimballons d’une pièce à l’autre en vue de réchauffer nos pieds et nos doigts gourds n’améliorent en rien cette humidité débordante. Dans l’air, flotte une odeur de laine mouillée.
Ce printemps morose et froid ne ressemble à aucun autre, je ne m’en offusque pas ; voilà deux jours, mon père est parti dans le plus grand secret. D’instinct, je pressens l’importance et la gravité de ce départ. Son retour coïncide avec une timide réapparition du soleil. Son teint me paraît plus clair, ses joues ont pris une belle couleur rose. Autour de lui planent des odeurs de fumée de bois, de mouton et de terre mêlées à celle du tabac qui ne le quitte jamais.
À quelques reprises, en croisant son regard, je l’ai senti serein et calme, plein de certitudes. Il parle plus que de coutume et dit des mots que je ne comprends pas toujours : trêve, référendum, indépendance. À ma mère, il raconte sa visite dans le maquis en des endroits reculés, secrets ; la frugalité de ces quelques jours passés dans des abris de terre battue ; la chaleur du thé et des hommes. Une question, dit-il va être posée aux gens de ce pays les plaçant devant un abîme vertigineux, un monde inconnu qui paralyse et exalte en même temps les rêves les plus fous : oui ou non décideront-ils d’être indépendants et souverains ?
Et puis les journées s’écoulèrent de plus en plus chaudes, de plus en plus lumineuses.
Au seuil de l’été, une fébrilité rare atteignit tout le village. Une rumeur courait tel le souffle du vent sur les épis de blé : un référendum aurait bien lieu et ce serait pour le 1er juillet.
Dès lors, on entendit fredonner ces airs révolutionnaires longtemps interdits qui parlaient de la douleur des femmes dont les fils et les maris étaient morts au combat mais aussi de l’espérance retrouvée.
Les enfants jouaient ouvertement à la guerre avec des fusils de bois qui terrassaient l’ennemi à tous coups. Et des interrogations surgirent : à quoi ressemblerait notre drapeau ? Sans doute sera-t-il blanc et vert couleurs de pureté et d’espoir avec peut être une étoile ou un croissant rouge symbole de la foi musulmane. Quand à l’hymne national, ce chant des maquisards, nul ne l’avait encore entendu.
Le jour prévu, le verdict tomba. À une écrasante majorité nous voulions la paix et que cesse l’horreur, afin de voir grandir les enfants de ce pays dans la beauté du monde et dans la voie sacrée de la vie.
À présent nous avions cinq jours pour préparer les festivités.
Le village était une véritable ruche, les jardins furent plantés de mille fleurs éclatantes, les rues et les trottoirs lavés à grande eau.
Notre maison fut transformée en atelier de couture. Nuit et jour, ma mère confectionnait des fanions, des brassards, des chemisettes et autres vêtements aux couleurs du pays : pas un mètre de notre plancher qui ne fut envahi par des montagnes de tissu vert, blanc et rouge. Continuellement, j’entendais le bruit de la pédale de la machine Singer que son pied actionnait pour faire avancer l’aiguille. Sa joie et son entrain étaient communicatifs et ses chansons débordaient d’optimisme.
Mes sœurs et moi eûmes droit à de magnifiques robes couleur amande agrémentées de rubans verts et blancs. La veille de la célébration, il fallut nous laver méticuleusement et appliquer un rond de pâte de henné dans nos paumes de main qui, une fois enveloppées dans des bandelettes de tissus nous donnaient l’allure de boxeurs maladroits.
Enfin le grand jour arriva. Impossible d’imaginer matinée plus belle. Le ciel si bleu, si pur était une immense toile tendue sans pli. L’air zéphyrien déplaçait des arômes de roses sauvages et de miel. Sur les fils électriques, les oiseaux passereaux en rang serré piaillaient à tue-tête, joyeux et fous, cou et bec tendus.
Des drapeaux ondoyaient mollement au vent partout où cela était possible : sur les arbres, sur les frontons des maisons et des rares édifices et sur tout ce qui roulait.
Par grappes de plus en plus denses, les gens affluaient vers la rue et la place principales. Bientôt une marée humaine envahit les moindres recoins du village. Rien de spécial n’avait été planifié, pas de fête organisée, chacun était là pour partager sa joie, attester de sa présence en ce jour unique.
Les femmes se prenaient par la taille et dans une même respiration lançaient des youyous stridents auxquels venaient répondre les barouds des mousquets que les hommes tenaient à bout de bras.
En certains points, des kiosques avaient été installés ; ils regorgeaient de boissons fraîches et de beignets frits roulés dans du sucre. Les enfants, tout de neuf vêtus, couraient d’un étal à l’autre ingurgitant des quantités monstres de limonade.
Vers la mi-journée, de l’extrémité ouest du village surgit un cortège de camions et d’hommes dans un ordre approximatif. Ils étaient, pour la plupart d’entre eux, revêtus d’un burnous de laine écrue. Seuls les fusils en bandoulière et les grosses Pataugas apportaient une touche militaire à leur tenue. Leurs visages étaient fermés, le regard sombre scrutateur. Au fur et à mesure de leur avancée, des sourires apparurent puis une franche détente les envahit, enfin ils entonnèrent en cœur d’une voix profonde et grave l’hymne national.
Je me tenais en retrait, intriguée par ces combattants qui, jusqu’à ce jour, n’avaient été dans mon esprit que des ombres irréelles ; je cherchais en eux mon armée imaginaire peuplée de surhommes mystérieux et exaltés, mélange de cruauté nécessaire, et de détermination aveugle, entière, et dont les exploits et les actions entendus ici ou là jetaient dans mon jeune esprit confusion et rejet ou, à l’opposé, fierté et joie intense !
Bientôt, les camions furent pris d’assaut par une population enthousiaste. Les enfants voulaient tâter les fusils et les hommes s’embrassaient avec effusion.
Tout à coup, j’aperçus ma mère debout sur le marchepied d’un de ces camions du côté passager. Son corps penché vers la droite et le bras droit tendu dans les airs formaient un V avec la portière à laquelle elle s’agrippait. Son visage rayonnait, ses cheveux bouclés aux épaules lançaient des reflets auburn sous l’effet du henné et des rayons de soleil. Jamais encore je ne l’avais vue ainsi tout à fait seule dans la rue sans son voile et sa voilette de fine soie blanche et sa hardiesse me surprît. À coup sûr, elle fêtait une libération double : celle d’un peuple et la sienne propre.
Un moment nos regards se croisèrent, spontanément elle eut la grâce de souffler dans ma direction un léger baiser que j’attrapais au vol pour venir le déposer sur mon cœur.
Ainsi, riante et libre, je l’aimais tant !
Djaouida Challal
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021