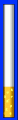La leçon coranique
Un souvenir de Bougie,
Été 1959
La leçon coranique
Longtemps, l’essentiel de mon éducation religieuse ne tînt qu’en quelques rites : Je connaissais la Bismillah et le Hamdoullah qui commençait et clôturait un repas,
J’aimais les soirées de Ramadan dont la rupture de jeûne était annoncée par un coup de canon lorsque le ciel s’enflammait de pourpre. Le silence qui s’ensuivait puis la joie recueillie qui envahissait les foyers.
J’entends encore les longues litanies des veillées funéraires et les cris paroxystiques des femmes pleureuses.
Je savais aussi reconnaître les jeunes garçons tout juste circoncis à leur démarche maladroite, leur gandoura tâchée de rouge et je me souviens encore de mon étonnement pour cette toilette rituelle méticuleusement effectuée avant chaque prière avec à peine une mesure d’eau dont chaque goutte semblait si précieuse et si rare.
L’été de mes huit ans, dès la première semaine de juillet, je me rendais une matinée par semaine à l’école coranique en haut de la ville dans le quartier arabo-espagnol.
Pour y parvenir, il fallait gravir un petit chemin de terre poussiéreux et chaud. Des pierres plates étaient disposées cà et là entre lesquelles coulait un mince filet d’eau verdâtre, iridescente. De chaque côté du chemin, de petites maisons basses à une seule pièce s’ouvraient sur une cour où un figuier dispensait un peu d’ombre et mêlait son odeur douceâtre aux pestilences de l’eau.
À mi-chemin, je rencontrais Kader accompagné de son âne chargé de paniers de sardines luisantes et bleues. Longtemps après son (leur ?) passage subsistait dans l’air la vibration du i du sardiiiiiine hurlé à la ronde et étiré comme un élastique qui venait ensuite percuter les pâles poussiéreuses des figuiers de Barbarie.
L’école se trouvait au bout du chemin à droite adossée au maquis. De couleur bleu-poudre, elle semblait concentrer sur elle toute la lumière. Une seule pièce la constituait et trois fenêtres dispensaient une lumière crue et blanche à peine filtrée par des bosquets de lauriers roses qui cachaient la montagne.
Quand j’y pénétrais la première fois, le Maître était assis dans la seule zone d’ombre à droite de la porte, face à l’Est, dans la position de prière, le poids du corps reposant sur le pied gauche. Il était vêtu d’une veste grise très ajustée au corps et qui laissait dépasser un col fermé et des poignets de chemise blancs. De taille plutôt fluette, son visage aux traits fins arborait un léger duvet au dessus des lèvres obstinément closes et dans la tension des muscles faciaux, perçait un rien d’irritation ; des lunettes noires aux verres épais donnaient à l’ensemble du visage une sévérité non feinte.
Je pris place au fond sur le sol tapissé de nattes de jonc aux dessins géométriques harmonieux à deux ou trois tons de rouge, de brun et d’ocre.
La salle se remplit tranquillement, le maître face à nous n’avait pas bougé d’un pouce, bien droit, attendant patiemment que l’agitation prit fin. Mystérieusement, le silence se fit, complet.
À sa gauche, se tenait un jeune garçon d`une douzaine d’années, à peine moins grand que le maître, sérieux dans sa gandoura blanche. Il se leva et nous distribua une tablette de bois aux bords arrondis, un encrier contenant un liquide noirâtre à l’odeur médicamentée légèrement camphrée reconnaissable entre mille. Puis, il nous mit dans la main une tige de roseau taillée en plume.
Enfin, le maître leva les mains et ouvrit les paumes, puis il récita
Le jeune garçon à ses côtés prit alors sa planche de bois et nous indiqua comment la poser sur la cuisse droite, le haut appuyant sur l’avant-bras gauche. Ensuite, il inscrivit à l’encre noire délavée la Bismillah rituelle et nous invita à en faire autant ; Je traçais péniblement ces quelques lettres en arabe découvrant une calligraphie qui me ravissait, pleine de rondeurs et de traits langoureusement étirés.
Nous poursuivîmes ainsi avec chacune des phrases du premier verset : nous les écrivions et nous les récitions autant de fois que le maître le jugeait nécessaire ; quand la récitation semblait à son goût, il déviait doucement son visage vers celui de l’adolescent : cela était assez, il pouvait passer à la phrase suivante.
Ces versets étaient le maillon d’une chaîne qui reliait son esprit à celui des autres, le lien tangible entre lui et le monde.
Des fenêtres ouvertes, pénétrait une brise légère et tiède sur laquelle voyageaient par vague les versets psalmodiés. Doucement, je sentais mes paupières s’alourdir, un bien-être me gagnait, je me laissais bercer par le rythme syncopé des phrases, j’étais dans une bulle éthérée planant dans l’immensité cosmique. Mais le maître restait vigilant et du bout de sa longue baguette veillait à surprendre les âmes assoupies par quelques coups bien placés ; Je fus donc rapidement ramenée sur la natte de jonc.
Enfin, une toute dernière fois, il tourna son visage vers son assistant et celui-ci mit fin au cours.
Le maître se leva, ajusta sa veste vers le bas et sembla hésiter un instant. Rapidement le jeune adolescent lui tendit une canne et se posta devant lui. Le maître déposa alors tranquillement sa main droite fragile et blanche comme de la porcelaine sur l’épaule du garçon et ainsi, frères siamois, ils empruntèrent le chemin.
Je les suivis du regard quelques instants puis me mis à dévaler la pente avec comme guide en contrebas la mer immuable et bleue.
Par Djaouida Chalal
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021